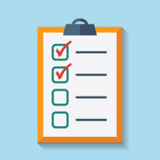Nouvelles
Une nouvelle vision du logement pour aînés
En juillet 2015, environ 5,8 millions de Canadiens étaient âgés de 65 et plus (16 % de la population), selon Statisque Canada. Bon nombre d’entre eux sont en santé, mais sont conscients que cela pourrait changer dans les décennies à venir. Insatisfaits des options de logement actuelles destinées aux aînés (p. ex. foyers et maisons de soins infirmiers), ils veulent créer une communauté solidaire, avant que leur situation ne change.
S’inspirant d’une idée lancée au Danemark dans les années 1960, les Canadiens vieillissants s’ouvrent aux options de vie en unités individuelles dans un complexe à aires partagées, des cuisines communautaires par exemple, dans un modèle qui encourage l’interaction tout en ménageant la vie privée. Ces options comprennent le cohabitat, les coopératives, les logements partagés ou communautaires, et les collectivités de retraités naturellement établies (lorsqu’un quartier existant devient une collectivité de personnes de l’âge d’or).
Qu’est-ce que le cohabitat?
À l’origine, tout cohabitat1 était intergénérationnel, c’est-à-dire que les résidents étaient surtout des membres de jeunes familles, avec quelques aînés. Certaines personnes les décrivent comme un retour aux bonnes vieilles petites villes. D’autres les considèrent comme un village traditionnel ou un quartier tricoté serré, alors que les futuristes les appellent une nouvelle réponse aux défis sociaux, économiques et environnement aux du 21e siècle.
En fait, chacun a un peu raison. Le cohabitat est un concept qui a fait son apparition en Amérique du Nord en 1988. Environ 160 communautés de cohabitat ont été mises en place sur le continent depuis 1991 et il y a actuellement plus 100 nouvelles communautés en développement.
Les résidents du cohabitat participent à la planification, à la conception, à la gestion courante et à l’entretien de leur communauté, au gré de rencontres fréquentes. Les quartiers de cohabitat tendent à offrir des designs respectueux de l’environnement, axés sur le trafic piétonnier. Ils comptent généralement de 10 à 35 ménages, proposant un ensemble multigénérationnel de célibataires, de couples, de familles avec enfants et d’aînés. Le niveau d’interaction sociale et de mise en commun des ressources varie selon la communauté.
La forme d’un établissement de cohabitat n’est limitée que par l’imagination, les désirs et les ressources des personnes qui travaillent activement à créer leur quartier selon des principes démocratiques et un désir fondamental de créer un environnement de logement plus pratique et social.
Quels sont les avantages des logements partagés?
Les logements partagés pourraient aider à préserver la santé des cerveaux des aînés.2
« Je crois qu’il s’agit d’une idée merveilleuse pour préserver les liens sociaux chez les aînés », indique Nicole Andersen, Ph. D, neuropsychologue clinicienne et scientifique principale à l’institut de recherche Rotman (centre Baycrest).
« Le manque de connexions et d’appuis sociaux est lié à toute une série de problèmes », explique Mme Anderson, y compris la dépression, une santé défaillante et une qualité de vie moindre. « Les personnes qui manquent de connexions sociales courent un plus grand risque de souffrir de démence et d’une diminution de leurs capacités cognitives », ajoute-t-elle. « Le fait d’avoir des gens près de vous, lorsque vous avez besoin d’aide ou d’appui, est extraordinaire. »
L’intérêt porté au concept devrait croître avec le vieillissement de la population; et la plus grande volonté de résidents de vivre en étroite proximité montre que le cohabitat a de plus en plus la cote, à mesure que la population reconnaît ses avantages et tire des leçons des communautés existantes.
Sources:
1http://cohousing.ca/what-is-cohousing
2Housemates wanted: a new vision for seniors housing, Lorenda Reddekopp, CBC News, Nov 14, 2016.
3Quebec’s eldercare challenge: Embracing independence, Marian Scott, Montreal Gazette, October 23, 2015.